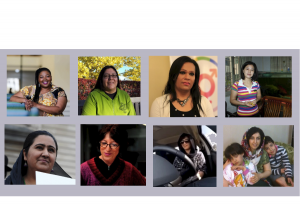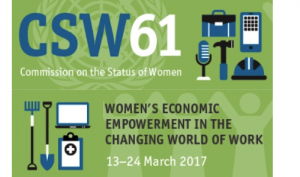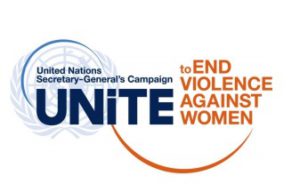. EGALITE HOMMES/FEMMES .
Un article de Internationale de l’Education
La délégation syndicale présente à New York, aux Etats-Unis, est composée de 150 femmes dirigeantes syndicales issues de 34 pays du monde, un nombre sans précédent. La délégation de l’Internationale de l’Education (IE) à la 60ème session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies (CSW60) a rejoint les autres délégations de fédérations syndicales internationales pour la première semaine des délibérations de la Commission (du 14 au 18 mars).

Cliquez sur le photo pour l’élargir
Nora Fyles, Responsable du Secrétariat de l’Initiative des Nations Unies pour l’éducation des filles (UNGEI). Fyles a donné une courte présentation portant sur le thème ‘Policy Advocacy: UNGEI Speaking Out for Girls’ Education’ (plaidoyer politique: l’UNGEI s’exprime pour l’éducation des filles), qui a été suivie d’une conversation avec les déléguées de l’IE au sujet des activités de plaidoyer de leurs syndicats respectifs sur le thème de l’éducation des filles et autres problématiques liées au genre et l’éducation.
Plus tard dans la journée, les déléguées de l’IE ont rejoint la délégation syndicale dans son ensemble pour une séance d’information lors de laquelle les délégué(e)s nouveaux/elles et aguerri(e)s ont reçu des informations concernant la première semaine de la CSW60, ainsi que sur les événements prévus par les fédérations syndicales internationales, l’Organisation internationale du Travail et les principaux alliés parmi les milliers d’organisations des droits des femmes actuellement présentes à New York pour assister à la CSW60.
Le thème prioritaire de la CSW60 est l’Autonomisation des femmes et lien avec le développement durable; et le thème examiné est l’Élimination et prévention de toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles (conclusions concertées à la CSW57). Le thème prioritaire est auspicieux car la CSW60 est le premier événement majeur des Nations Unies à se dérouler depuis que l’agenda pour le développement durable 2030 a été convenu, et les nouveaux objectifs de développement durable ont été adoptés en septembre 2015. La CSW60 représente donc une occasion unique de rassembler la communauté du genre et de l’éducation pour un dialogue autour des liens entre l’objectif de développement durable 4 sur l’éducation et l’objectif de développement durable 5 sur l’égalité des sexes.
Le mercredi 16 mars, en collaboration avec la mission de la Norvège auprès des Nations Unies et l’UNGEI, l’IE organisera conjointement un événement parallèle intitulé ‘Financement de l’éducation: une clé pour l’autonomisation des femmes et des filles’. La présidente de l’IE, Susan Hopgood, prendra la parole, ainsi que Tone Skogen, la Ministre adjointe des Affaires Etrangères de Norvège, Geeta Rao Gupta, Directrice exécutive adjointe de l’UNICEF, Meighan Stone, Présidente du Malala Fund et Justin van Fleet, Directeur de la Commission internationale sur le financement des opportunités éducatives dans le monde. L’événement sera animé par Yannick Glemarec, Directeur exécutif adjoint Politique et Programmes d’ONU Femmes, et les remarques introductives seront offertes par Alice Albright, Directrice générale du Partenariat mondial pour l’éducation.
Lire la déclaration conjointe officielle des fédérations syndicales internationales relatives à la CSW60, cliquez ici pour découvrir le travail des délégué(e)s syndicaux/ales.
Suivre la délégation des fédérations syndicales internationales à la CSW des Nations Unies sur Twitter : https://twitter.com/unioncsw .
(Merci à Janet Hudgins, le reporter de CPNN pour cet article)
(Cliquez ici pour une version anglaise.)
Does the UN advance equality for women?
The following article by Lyndal Rowlands in the Inter Press Service, suggests that the UN is not making much progress on its commitments for women’s equality:
2015 marks anniversaries for two significant commitments made to increasing women’s participation at peace tables.
Yet despite the Beijing Platform for Action and the Security Council Resolution 1325 both committing to increasing women’s participation in peace building 20 and 15 years ago, respectively, there has been very little progress to report.
The latest available statistics show that women made up only 9 per cent of negotiators at peace tables between 1992 and 2011. That the most recent data is from 2011 shows that more work is needed even in basic areas such as data collection and reporting of women’s participation in peace building.
IPS summarises here four reasons we should value women’s participation at the peace table more, based on discussions at the 59th Commission on the Status of Women (CSW) over the past week.
Beijing Platform for Action Section E
Women and Armed Conflict Diagnosis
Strategic objective E.1. Increase the participation of women in conflict resolution at decision-making levels and protect women living in situations of armed and other conflicts or under foreign occupation. Actions to be taken.
Strategic objective E.2. Reduce excessive military expenditures and control the availability of armaments. Actions to be taken.
Strategic objective E.3. Promote non-violent forms of conflict resolution and reduce the incidence of human rights abuse in conflict situations. Actions to be taken.
Strategic objective E.4. Promote women’s contribution to fostering a culture of peace. Actions to be taken
Strategic objective E.5. Provide protection, assistance and training to refugee women, other displaced women in need of international protection and internally displaced women. Actions to be taken.
Strategic objective E.6. Provide assistance to the women of the colonies and non-self-governing territories. Actions to be taken.
Women Bring Commitment and Experience to the Peace Table
Often the first people invited to participate in formal peace negotiations are the people holding the guns and the last are women who have expertise in building lasting peace.
Zainab Bangura, Special Representative of the Secretary-General on Sexual Violence in Conflict, told a CSW side event on Tuesday last week, “In the Central African Republic, the only community where they were not killing each other was a community where the Christian women said, ‘These Muslim women are our sisters.’
“Why? Because the women in the community said, ‘We have lived together for the last 100 years’,” Bangura said.
In the Phillipines, Irene Santiago was a member of the government panel that negotiated peace with the Moro Islamic Liberation Front. Santiago came to the table with years of experience working with Christian, Muslim and Indigenous women leaders for peace.
Speaking at a CSW side event at the International Peace Institute (IPI) on Thursday, Santiago said that she knew that her years of experience working with civil society for peace stood her in good stead to make a significant contribution to formal peace negotiations, which she did.
Speaking with IPS, Santiago said women’s voices not only have to be heard, but that they also have to be acted on.
“For women. It’s almost never always about themselves, it’s always about our children, our husbands but also about our communities,” Santiago told IPS.
In Africa, women have fought to be included in peacemaking, even when their contributions have not been recognised.
Bineta Diop, Special Envoy on Women Peace and Security to the African Union, says that mediators need to be held accountable when they only invite the people who hold guns to the peace table and ignore women’s contributions.
“I have been involved in many crises where women were knocking at the door and saying we want to be at the table,” Diop said.
Ambassador Anwarul Chowdhury, known as the father of Security Council Resolution 1325, said that the determination of African women to be involved in peace negotiations should be seen as an inspiration by other countries.
Despite serious difficulties, war and conflict, African women have shown continued determination to hold their countries accountable, Chowdhury said.
Gender Equality in Peace Time Prevents Conflict
Also speaking at the IPI, Valerie Hudson, co-author of ‘Sex and World Peace’, said that her research has shown that the way women are treated within a country is one of the most accurate indicators of the quality of relations that country will have with other countries.
Diop agreed with Hudson, saying that countries that are likely to fall into conflict have higher levels of discrimination and inequality.
“Discrimination against women, especially the non-participation and non-inclusion of women in democracy is … one of the root causes of the conflict,” Diop said.
Ambassador Choudhury agreed with these sentiments, telling IPS, “I believe that no country can claim that their country is not in conflict if women’s rights are denied, if women’s equality is not ensured, if women’s participation at all participation levels is not there.
“I think that if we women are violated, if women’s equality of participation is not there we cannot say that we are at peace, we are in conflict with ourselves. This is a conflict which is happening within ourselves and within the countries. We don’t have to go into the traditional description of conflict, civil conflict or fighting with another country,” Chowdhury added.
Dr. Youssef Mahmoud, Senior Adviser at the International Peace Institute also speaking at the IPI event said, “A world where 51 per cent are ignored is a dangerous world for everyone. I can’t imagine why any men would be indifferent to this.”
Women Are Active In Civil Society
Several discussions at the CSW questioned why militaries were the primary actors in peace building, while non-governmental organisations (NGOs) and civil society’s expertise was not called on.
Related IPS Articles
U.S. Honours 10 “Extraordinary Women” for Courage and Leadership
Meet the 10 Women Who Will Stop at Nothing
Women Walk for Peace in the Korean Peninsula
Santiago told IPS that civil society, especially women, have a lot to contribute to humanise, to concretise, and to make peace negotiations relevant to people’s lives.
Winnie Kodi from the Nuba mountains in Sudan told reporters on Monday that civil society was vital to helping indigenous communities like her own that have been affected by conflict. She said that the main way her people were able to have their voices heard was by working together with NGOs and civil society.
Chowdhury told IPS he is advocating for the U.N. and governments to hold more consultations with civil society, saying that the involvement of women and of civil society is very important.
Santiago also called for renewed focus on the important role of NGOs in the area of women, peace and security,
“Again I see that why are we focusing on the UN as the locus of change,” she said. “To me it is not, it is the means, it is an important audience, but it is not the locus of social change.
“Let us form the global civic networks that we need to bring about the local global and civil change that we need” Santiago said.
Women Challenge The Causes of Conflict
Challenging militarism and militarisation was another theme discussed during the first week of the CSW, particularly by civil society groups at the parallel NGO forum.
Choudhury told IPS that increased militarism and militarisation is slowing down efforts for equality. “Increasing militarism and militarisation has really been effecting women in a very negative way. This is something that women should stand up against, we should all stand up against,” Chowdhury said.
Militarisation is also affecting indigenous women and men. Maribeth Biano, from the Asian Indigenous Women’s Network, told reporters on Monday that Indigenous women are hugely affected by militarisation in Indigenous territories.